Il pourrait sembler au mieux naïf, au pire contre-productif, de concevoir un projet dans le cadre national alors que les enjeux économiques, géopolitiques et surtout climatiques exigent évidemment une réponse mondiale. Un changement français ne serait-il pas dérisoire devant l’ampleur de la tâche, et les efforts consentis ne pénaliseraient-ils pas la France par rapport aux autres pays ? En réalité il y a d’excellentes raisons de proposer un projet national.
Une solution internationale est complètement hors d’atteinte actuellement, comme le montrent chaque jour les tensions, querelles et dissensions mondiales. Il est totalement illusoire d’espérer des mesures mondiales un tant soit peu ambitieuses dans l’immédiat. Un projet mondial à court terme ne peut donc être qu’un vœu pieu (et, pour paraphraser Keynes, à long terme nous sommes tous morts).
Malheureusement, les mêmes raisons rendent encore irréaliste l’élaboration d’un projet européen, bien que les désaccords au sein de l’UE semblent avoir légèrement reculé depuis l’élection de Donald Trump. L’UE (ou la zone euro) serait pourtant l’échelle naturelle pour un projet social, économique et écologique, à la fois pour son poids démographique et économique que pour son influence internationale. Mais l’UE (et la zone euro) s’est construite sur une idéologie du libre marché, de la concurrence et de la croissance économique, incompatible avec un véritable projet humaniste et écologique. Renier ces principes fondateurs à l’unanimité des vingt-sept États membres semble totalement chimérique à cause de la faiblesse de la démocratie européenne. On voit d’ailleurs ce qui rassemble actuellement les dirigeants européens : ce sont les dépenses d’armement et la recherche de la croissance économique à tout prix, en dehors de toute aspiration sociale et écologique.
Le cadre national n’est pas épargné, bien sûr, par l’idéologie néolibérale ni par une sclérose politique et institutionnelle. Néanmoins, les leviers paraissent moins difficiles à manœuvrer, plus proches de nous et mieux connus. L’action associative et locale est à notre portée. Une culture politique moins hétérogène avec un ancrage social plus marqué que dans d’autres pays européens, une tradition contestataire toujours bien présente, un tissu associatif vivant, une large acceptation des enjeux environnementaux, une situation politique qui effraie une bonne partie de la population : les ferments sont déjà là pour d’éventuels changements d’ampleur. Cela ne doit toutefois pas faire oublier que, à quelque échelle que ce soit, le chemin est tout sauf évident.
Un changement profond et réussi en France peut en revanche, et c’est l’espoir que nous entretenons, inspirer de nombreux autres peuples dans le monde. Nous pensons en particulier à quelques-uns de nos voisins européens bien sûr (par exemple l’Espagne, certains pays scandinaves, etc.), mais aussi à de nombreux pays peu à l’aise avec l’agenda extractiviste et néolibéral (Brésil, Amérique centrale, Afrique, etc.). Ce mouvement est aujourd’hui facilité par le repoussoir que sont devenus les États-Unis de Trump. L’expérience montre qu’il suffit parfois de rallier une petite proportion de la population pour atteindre un point de bascule et faire boule de neige : on parle souvent1 d’un seuil de 3,5 %, qui correspond à seulement quatre pays comme la France.
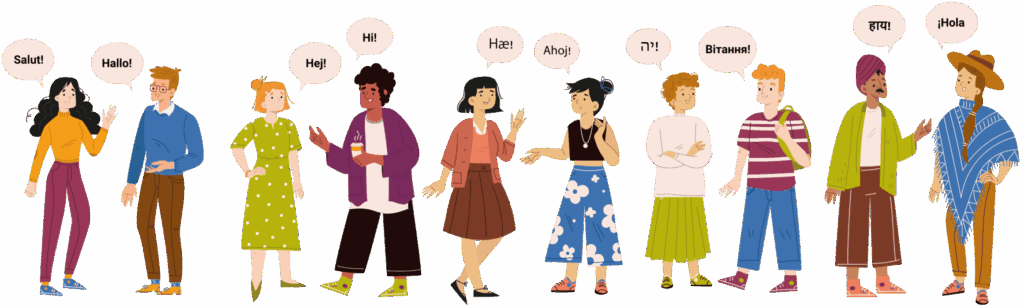
Le modèle que nous proposons se veut en effet ouvert et transposable à d’autres pays. Ouvert dans sa philosophie de coopération, d’inclusion et de partage plutôt que de compétition et de concurrence. Transposable car a priori compatible avec les règles européennes et mondiales, résilient et adaptable aux situations variées des différents pays. En particulier, pour les enjeux climatiques mondiaux, la coopération paraît bien plus efficace que la compétition pour échanger les dernières technologies propres de sobriété et les meilleures pratiques plutôt que de garder jalousement les secrets industriels et retarder leur déploiement mondial en interdisant leur accès aux populations plus pauvres. Ainsi, une taxation privilégiant le développement local n’est nullement synonyme de repli sur soi et recul technologique : bien au contraire, comme nous l’avons vu elle est essentielle à la résilience accrue d’un système mondial qui sera durement éprouvé à l’avenir, et plutôt que des traités de libre échange, des coopérations bilatérales ou multilatérales permettent une diffusion à toutes les populations des idées et innovations techniques. Nous pouvons donc imaginer avancer avec de nombreux pays désireux de prendre à bras le corps les problèmes environnementaux et sociaux qui les touchent tant, dans une alliance entre pays développés et en développement tournant résolument le dos aux politiques économiques mortifères actuelles. Par ailleurs, il devient clair que l’avenir se situe autant, voire davantage, en Asie, Afrique et Amérique du Sud que dans un Occident déchiré.
Enfin, l’argument tant rebattu d’un préjudice auto-infligé au pays qui ferait seul l’effort d’une transition ne soutient pas une analyse sérieuse. D’une part, cet argument empêche le monde entier d’avancer alors que l’urgence n’est plus à montrer. D’autre part, tout indique au contraire que ce pays, en organisant une bifurcation que tôt ou tard chacun devra subir, se donne une avance considérable par rapport aux autres pays qui continueraient à promouvoir l’extractivisme et à accentuer les inégalités. La résilience et le lien social apportés par nos propositions, notamment, sont évidemment des atouts cruciaux dans un avenir incertain. Diverses études économiques confirment d’ailleurs elles aussi le bénéfice économique d’agir le plus tôt possible2.
- Sources : Why civil resistance works, Erica Chenoweth et Maria J. Stephan, Columbia University Press, 2011 (traduction Pouvoir de la non-violence, Calmann-Lévy, 2021) ; et conférence TedX d’Erica Chenoweth, The success of non-violent civil resistance, 04/11/2013. ↩︎
- Lire par exemple Investing in Climate for Growth and Development, OCDE et ONU 2025. ↩︎
