
L’ambition
Verser l’indemnité citoyenne et le revenu compensatoire de la PPRS en monnaie locale permet de ne pas grever le budget de l’État, puisque l’on peut créer cette monnaie ex nihilo (c’est-à-dire « gratuitement », sans contrepartie). Il faut toutefois provisionner en euros une partie du montant versé pour la caisse de compensation qui permet aux professionnels accumulant trop de monnaie locale de l’échanger contre des euros.
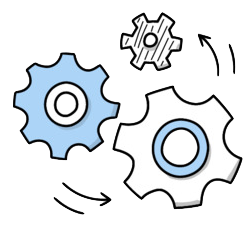
Le fonctionnement
Plus précisément, l’indemnité citoyenne de 580 € et la PPRS de 750 € représentent une grande part de la monnaie en circulation et le risque est que les professionnels (commerçants par exemple) soient payés principalement en monnaie locale au détriment de l’euro (ce qui signifierait qu’ils seraient lésés puisqu’ils ne pourraient dépenser leurs bénéfices que localement et ne pourraient pas épargner).
En effet, les 414 milliards d’euros annuels d’indemnité citoyenne répartis parmi 46 millions d’UC1 représentent en moyenne 750 €/UC mensuels, à ajouter à la PPRS de 750 € également pour un total moyen de 1 500 €/UC versé en monnaie locale.
De l’autre côté, les 25 millions d’équivalent2 temps-plein à un salaire moyen3 de 2590 €/mois versé en euros, qui rapportent 777 milliards d’euros actuellement, seront amputés de 10/35 de leur valeur par la réduction du temps de travail.
En prenant en compte la hausse du nombre d’emplois de 1,6 million comme vu à l’article « Indemnité citoyenne », cela représente une baisse de l’ordre de 186 milliards d’euros, soit 337 €/UC/mois. Avec en 2021 un revenu moyen mensuel de 2 200 €/UC4, la part du revenu mensuel par UC versée en euros est donc d’environ 1 863 €, et celle en monnaie locale de 1 500 comme nous l’avons vu, soit 44,6 % du total d’environ 3 360 €/UC/mois.
La question se pose de savoir si les régions sont capables de produire suffisamment de biens (et services) localement pour assumer cette part de monnaie locale, ou s’il faut plutôt aller progressivement jusqu’à un tel montant.
Quid de la caisse de compensation
Il reste maintenant à estimer les sommes en jeu pour la caisse de compensation.
Le principe est le suivant : si une entreprise est payée à plus de (disons) 40 % en monnaie locale, il faut pouvoir lui échanger par des euros les unités de monnaie locale qui dépassent ce seuil.
Ainsi, la caisse de compensation doit par exemple être capable de verser, en échange d’un montant équivalent de monnaie locale, 40 000 € à un commerçant dont le chiffre d’affaire est de 100 000 € et qui aurait reçu 80 % de celui-ci en monnaie locale. Le choix du seuil de 40 % se fait notamment selon les considérations suivantes et peut éventuellement varier en fonction de la situation de l’entreprise, du secteur d’activité ou pour d’autres raisons :
les salaires (un cinquième du chiffre d’affaire en moyenne)5 restent payés en euros bien sûr ;
le reste, soit 80 % (essentiellement les consommations intermédiaires pour environ 70 % du chiffre d’affaire en moyenne6, et l’excédent brut d’exploitation), peut être payé jusqu’à la moitié en monnaie locale comme c’est le cas des ménages (49 % des dépenses en monnaie locale, cf. ci-dessous). Régler ses consommations intermédiaires en monnaie locale encourage ainsi l’entreprise à s’approvisionner auprès d’entreprises locales. Au total, on arrive donc à 40 % maximum du chiffre d’affaire versé en monnaie locale.
Pour que chaque entreprise soit incitée à faire vivre l’économie locale, et afin de réduire la provision de la caisse de compensation7, on instaure également un mécanisme symétrique : si une entreprise est payée à plus de (disons) 75 % en euros, elle doit échanger par de la monnaie locale les euros qui dépassent ce seuil. Ainsi, après compensation, le chiffre d’affaire de chaque entreprise est composé de 25 % à 40 % de monnaie locale.
L’immense majorité du revenu moyen d’un ménage, 91 %8 environ, est dépensé en consommation. Nous supposerons que cette proportion reste sensiblement équivalente lorsque le revenu mensuel moyen par UC passe à 3 360 € (cf. ci-dessus), en prenant en compte la baisse des revenus du travail et les 1 500 € de revenu citoyen partiel. Ainsi, une UC dépenserait mensuellement 3 060 € TTC, et puisque la monnaie locale est fondante, on peut imaginer que celle-ci sera systématiquement dépensée en premier par les consommateurs. Cela correspond donc à 1 500 € de monnaie locale dépensée (49 %) et 1 560 € dépensés en euros.
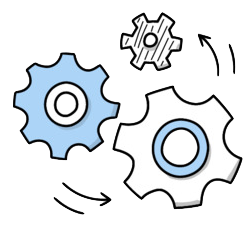
Selon ces hypothèses, en prenant une taxe de PPRS moyenne à 100 %, la consommation hors taxe totale des ménages s’élève à environ 845 milliards d’euros par an, dont 414 payés en monnaie locale. Pour cette consommation, la compensation maximale possible est atteinte lorsqu’une proportion p de ces 845 milliards d’euros (chiffre d’affaire global de toutes les entreprises vendant à des particuliers) est versé à 25 % en monnaie locale (ces entreprises n’ont rien à verser ni à recevoir), et la proportion restante (1–p) est à 100 % de monnaie locale (qu’il faut donc compenser à hauteur de 60 %). On a alors 0,25p + (1-p) = 0,49 (proportion totale de monnaie locale dans les dépenses des ménages), soit p = 0,68, et dans ce cas, il faut provisionner 0,6*(1- p)*845 = 162 milliards d’euros.
Reste le cas des entreprises dont les revenus proviennent d’autres entreprises, pour environ 3 280 milliards d’euros9, dont il convient de retirer les entreprises exportatrices évidemment payées en euros (pour environ 936 milliards d’euros10). Entre 25 et 40 % de leur chiffre d’affaire restant (2 344 milliards d’euros) est payé en monnaie locale. Toujours dans le cas le plus défavorable, 68 % des entreprises ci-dessus (dont les revenus proviennent des particuliers) ont 25 % de leur chiffre d’affaire en monnaie locale, soit une proportion de 31 % si l’on exclut les salaires. Elles paient donc leurs consommations intermédiaire à 31 % en monnaie locale, ce qui ne nécessite aucune compensation. De même au deuxième tour, la proportion de monnaie locale s’élève à 39 % et ne nécessite pas de compensation, pour un total de 0,68*845*(0,7 + 0,7*0,7) = 684 milliards d’euros11. Il reste donc 1 660 milliards d’euros toujours payés à 40 % en monnaie locale. En excluant les salaires (sur les 80 % restants, donc), chaque entreprise paie ses consommations intermédiaires à 50 % en monnaie locale. Il faut donc 10 % de compensation, pour un montant d’environ 166 milliards d’euros.
Au total, la compensation maximale est d’environ 328 milliards d’euros. Cette compensation maximale n’étant probablement pas atteinte, on pourra supposer que 300 milliards d’euros de provision suffisent.
Au bilan
Il reste à comprendre les recettes générées par la PPRS12, puisqu’une partie de celles-ci est versée en monnaie locale. En première approximation, nous considérerons que les revenus correspondent à 51 % des recettes estimées à l’article sur la « PPRS » , soit 380 milliards d’euros, puisque 51 % des dépenses de consommation restent effectuées en euros comme nous l’avons vu. Du côté des dépenses, seule la caisse de compensation doit être provisionnée puisque le montant compensatoire de la PPRS et l’indemnité citoyenne sont tous deux versés en monnaie locale. Nous avons donc 300 milliards d’euros de dépenses, face à 200 milliards d’euros de baisse d’aides sociales (voir l’article sur l’« Indemnité citoyenne ») et 380 milliards d’euros de taxe sur la surconsommation, soit 280 milliards d’euros de recettes nettes. Cela représente 75 milliards d’euros de plus que l’actuelle TVA (voir l’article sur la « PPRS »).

Incidence sur la consommation
On pourrait s’étonner de ce qu’utiliser des monnaies locales plutôt que l’euro réduise les coûts de ces mesures, ou s’inquiéter de ce que la quantité de nouvelle monnaie mise en circulation puisse provoquer une forte inflation. Cette monnaie locale créée ex-nihilo et qui ne rapporte rien (pas de rentrées fiscales) peut en réalité simplement être vue comme une autre façon de redistribuer, la consommation excessive étant taxée au profit d’une consommation de qualité : il ne s’agit que d’un transfert de richesse qui n’est pas censé provoquer d’inflation incontrôlée. Par ailleurs, la hausse des prix est déjà intégrée au dispositif de la PPRS, et même supérieure à l’effet naturel auquel on pourrait s’attendre avec cette injection de nouvelle monnaie puisque, comme vu à l’article sur la « PPRS », l’impact devrait être dissuasif pour la consommation.
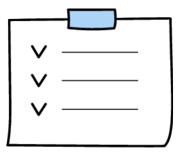
- Pour uniformiser les calculs, nous raisonnerons par unité de consommation. ↩︎
- Source : INSEE. ↩︎
- Source : INSEE. ↩︎
- Source : INSEE, 2021. ↩︎
- Source : INSEE. ↩︎
- Source : INSEE. ↩︎
- Dans ce but, on peut également imaginer autoriser chaque entreprise à n’accepter que, disons, 80 % de monnaie locale au maximum dans chaque paiement, réduisant ainsi les besoins de compensation (mais restreignant aussi la portée du revenu citoyen partiel versé en monnaie locale). ↩︎
- Cf. INSEE par rapport aux 2 200 €/UC de revenu mensuel moyen en 2021 vu à l’article sur la « PPRS ». ↩︎
- Source : INSEE. ↩︎
- Source : Ministère de l’économie. ↩︎
- Calcul : les consommations intermédiaires, pour 70 % de leur CA (total 845 milliards d’euros), des 68 % d’entreprises payées par les particuliers à 25 % en monnaie locale (0,68*845*0,7), et les consommations intermédiaires (à nouveau 70 % de leur CA) des entreprises fournissant ces premières consommations intermédiaires et payées à 31 % en monnaie locale (0,68*845*0,7*0,7). ↩︎
- Taxer en moyenne à 100 %, comme suggéré avec le présent dispositif de PPRS, plutôt qu’à 20 % avec la TVA actuelle, correspond à une hausse moyenne des prix de 67 % environ. ↩︎

Laisser un commentaire